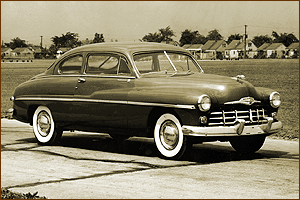Le mois d’août s’achevait tranquillement, pas vite, avec des soirées de moins en moins longues. Déjà les hirondelles avaient fait leurs adieux, juchées sur les fils électriques en rangs serrés, prêtes pour le départ. Pendant ce temps, à la maison, mes jeunes frères se traînaient d’une chaise à l’autre en clamant sur tous les tons : « M’man, j’sais pas quoi faire! » Il n’y avait pourtant pas si longtemps qu’ils avaient garroché leur sac d’école au fond d’un placard par un bel après-midi de juin en hurlant de joie : « Hourra! L’école est finie! »
Avec toute la bonne volonté du monde, maman disait : « Les autres p’tits gars, qu’est-ce qu’ils font? D’habitude, vous jouez ensemble… » Il s’en trouvait toujours un pour répondre : « On n’a plus rien à faire! » Alors maman suggérait des choses comme aller corder du bois tandis qu’il fait beau : « On en a cordé hier, en masse! »… Ramasser les patates dans le jardin : « Ah non! Pas ça! »… Aller se baigner, pendant qu’il fait encore assez chaud : « La mer est trop basse, ça adonne pas. » Ah oui! Vraiment, on était rendus à la fin d’août! Les jeux qui semblaient inépuisables au début des vacances n’intéressaient plus personne. On avait joué à la balle des soirées entières, on avait même cassé une vitre dans la fenêtre du hangar… moins grave que si ç’avait été une fenêtre de la maison. On avait joué aux « Quatre-Coins », au « Cinquante »; à ces jeux-là, les plus petits pouvaient jouer, ce qui finissait par ennuyer les plus grands. On avait joué à « En bas de la ville », dans la côte près du gros orme; on avait tellement de plaisir à ce jeu! Mais il y en avait toujours un qui déboulait en bas de la côte ou qui se faisait mal et qui « chialait », alors il fallait arrêter. Cet été-là, on avait surtout joué aux cow-boys et aux Indiens. Fernand avait pris des photos des combats avec le kodak qu’il avait eu à sa fête et c’était comme si on tournait de vrais films, pareil comme dans The Lone Ranger. On s’était fabriqué des fusils en bois, des arcs, des flèches – pas des vraies, voyons donc! Ceux qui jouaient les rôles des Indiens enlevaient leur chemise – maman aimait pas ça, elle disait qu’ils allaient attraper des coups de soleil – et ils se barbouillaient pour faire plus vrai. Fernand avait tourné au moins trois films. Si on compte qu’il y avait douze photos par film (en noir et blanc), ça donnait trente-six photos. Ça finissait par coûter cher!
On a épuisé tous les jeux, y compris ceux des jours de pluie : le Monopoly, les dames, le jeu de pichenotte, les jeux de construction, même les fameux scrapbooks que maman nous faisait confectionner avec de vieux cahiers et des images découpées un peu partout. Jusqu’aux plus jeunes qui avaient leurs cahiers de collage, dans lesquels ils mettaient n’importe quoi, n’importe comment. Juste pour vous donner un aperçu, dans un des scrapbooks, il y avait une image de Jésus qui était collée au-dessus d’un bol de soupe aux légumes Campbell… ce pauvre Jésus, il avait les pieds dans le plat! On l’a bien ri celle-là! On a lu tous les « petits comiques », pas rien qu’une fois… il y en a qui sont pas mal maganés, d’autres qui ont perdu des feuilles. On s’est promenés en bicycle, on a été aux framboises, aux bleuets et aux mûres. Les « môsusses » de mûriers! On en porte encore les égratignures! « Pour de vrai m’man, on sait plus quoi faire! » C’est comme si l’été n’était plus tout à fait l’été. Dire qu’au début on avait tellement hâte; on allait dans le jardin voir si les légumes poussaient… on trouvait que ça n’allait pas vite. Tout était amusant! On passait nos journées dehors quand il faisait beau, on rentrait juste pour les repas et pour aller se coucher.
Qu’est-ce donc qui s’est passé? C’est pourtant encore le mois d’août, les journées sont belles, moins chaudes un peu, mais on est bien dehors. Il y a plein de bons légumes dans le jardin, surtout du blé d’Inde. On en mange tant qu’on peut. Que peut-on désirer de plus! Les soirées sont superbes, même si le soleil se couche plus tôt. Les grands sortent le tourne-disque sur la galerie et on fait jouer les disques de rock’n’roll; on écoute Elvis Presley, Paul Anka, Dean Martin et tout plein de chanteurs à la mode. Mais, c’est plus pareil… Il y a quelque chose dans l’air qui est différent; c’est peut-être le « cri-cri » des criquets qui a remplacé le chant des oiseaux qui sont déjà partis.
Peut-être qu’on est rendus au temps où l’on commence à penser à l’école qui va débuter bientôt. Faudrait bien sortir les sacs, faire l’inventaire de ce qui est encore utilisable. « Ça va me prendre des crayons neufs, des effaces, certain. J’espère que je vais avoir une boîte de Prismacolor cette année… depuis le temps que j’en veux. Bon, demain on va voir à ça, demain… » Mais en attendant : « M’man, j’sais pas quoi faire! »
© Madeleine Genest Bouillé, août 2015