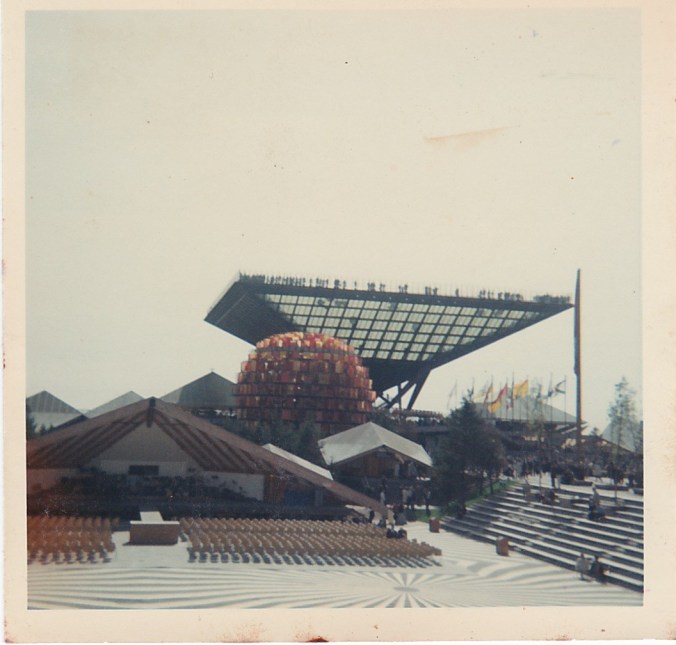Dans mon agenda 2020, à la page du jeudi 12 mars, en avant-midi, j’ai écrit ceci : « Que c’est beau le verglas au soleil! » C’était la troisième journée que la nature comme par hasard, se parait de fleurs de cristal… ce fut la dernière. À 10 heures, je suis allée chez ma coiffeuse. Je ne savais pas alors que je n’y retournerais pas avant un bon bout de temps! Un peu plus tard, mon petit frère Roger est passé faire un tour. Qui nous aurait dit alors qu’on ne se reverrait que deux mois plus tard, entre deux portes, et seulement pour une « commission »!
Mais je continue de lire la page du 12 mars : « Comme il fait beau, ça sent le printemps! » Pâques n’est que le 12 avril, mais comme j’ai toujours hâte de décorer la maison à chaque fête, je décide donc d’aller fouiller dans mes boîtes étiquetées « Pâques ». J’y passe un certain temps quand voici tout à coup que mon fils aîné et sa fille nous arrivent : panne d’électricité à Portneuf! Évidemment, on les garde à souper, mais ils ne repartent pas tard – on est jeudi, demain ce n’est pas congé. À la télévision, on attire notre attention sur le nouveau virus appelé justement Coronavirus, qui est en train de contaminer toute la planète. On en avait bien entendu parler quelque peu, mais il semble que ce virus, devenu pandémie, est rendu chez nous, au Québec!
On s’inquiète quand même un peu, puis un peu plus… Et voilà qu’on annonce la fermeture des commerces, des différents services. Dans le courant de la soirée, on apprend que la Bibliothèque doit fermer ses portes, jusqu’au 30 mars au moins, peut-être plus. Ce fut évidemment pas mal plus long! Et notre souper-spaghetti qui devait avoir lieu le 21 mars? Reporté… à on ne sait pas quand! Cette activité qui est notre principale levée de fonds et qui rassemble toujours une bonne centaine de convives va nous manquer.
Le soleil est couché, les arbres chargés de verglas n’attirent plus le regard. On n’y pense même plus. On est rivés devant la télé… on trouve ça quand même inquiétant. Et voici que le Premier Ministre M. Legault, dans un point de presse qui doit rejoindre le Québec en entier, annonce que toutes les églises seront fermées pour le culte. Plus de messes, ni de funérailles, encore moins de mariages et de baptêmes; jusqu’à quand? Personne ne le sait… On ne doit pas sortir de la maison sauf pour quelque chose d’important, et encore, on doit porter un masque.
À la fin de la page, j’ai écrit : « À la télé on ne parle plus que de ça, le Coronavirus! On finit par avoir peur… Je n’aime pas ça du tout. Oui, j’ai peur pour mes enfants, mes petits-enfants. Je n’ai pas mangé grand’chose aujourd’hui, ça m’a coupé l’appétit! »
C’était la page du 12 mars de mon agenda 2020.
© Madeleine Genest Bouillé, 12 mars 2021